La tourmente dans laquelle est entrée le pass Culture, qui a été une des Startups d’État les plus visibles de beta.gouv.fr, se répand en critique plus générale du modèle, au motif que les Startups d’État n’auraient eu d’autre but que de promouvoir l’alignement du secteur public sur le secteur privé, vieille antienne remise au goût du jour dans un jargon start-up :
A l’heure où plus de 75 Startups d’État se développent dans des dizaines d’administrations centrales et territoriales, plusieurs d’entre elles sont devenues des services publics nationaux reconnus, dont certains viennent d’ailleurs d’être listés dans les « 50 pépites de la Govtech » (PIX, mes-aides, Signaux Faibles et LaBonneBoite). Malgré ces succès alliant frugalité et utilité, le terme Startup d’État, hérisse de nombreux contempteurs de l’action du gouvernement, sur fond d’indigestion de Startup Nation.
Mais revenons au début de cette affaire, le pass Culture :
… Faisant fi de la logique des start-up d’Etat selon laquelle un agent public remonte un problème de politique publique pour tenter mieux le cerner puis d’explorer des manières de le résoudre, “le gouvernement est venu nous voir avec un problème de politique publique bien défini, et même la solution” … (Acteurs Publics)
J’ai travaillé pendant 6 ans à l’édification de beta.gouv.fr que j’ai quitté à l’été 2019. Mon objectif personnel était de redonner du sens au travail au sein de l’administration, qui, comme la plupart des grandes organisations, souffre des nombreux maux de la bureaucratie : inefficacité, désengagement, burn-out, bullshit jobs.
Le terme “Startup d’État”, forgé pour faire pénétrer de nouvelles méthodes dans l’administration, date donc de 2013… avant la “Startup Nation”. La note Fondapol « Pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance » développait ce concept, que j’avais introduit sur mon blog en avril 2013, inspirée (en creux !) par Fleur Pellerin et ce qui allait devenir StationF…
Avec Henri Verdier nous avons construit la première Startup d’État, data.gouv.fr. Puis j’ai eu la chance de rencontrer d’autres agents publics pour développer des réponses à d’autres problèmes de politique publique (difficulté d’accès aux marchés publics, non-recours aux prestations sociales, à la formation professionnelle, etc.). Mais nous n’avons pas cessé de discuter ensemble et avec les équipes de ce sujet. Nous sentions bien que le terme startup allait laisser une odeur de « privatisation du service public », de « néo-libéralisme », de « recherche de profit plus que d’intérêt général », là où nous ne créions que des équipes obéissant à un manifeste : sens (l’utilité pour les usagers du service public avant les besoins de l’administration), autonomie (de l’équipe face au reste du système) & amélioration continue (l’équipe demeure en charge de la politique publique pour l’adapter).
Dans un post récent, Ishan Bhojwani, un responsable de beta.gouv.fr, appelle ainsi à substituer à la jargonnite Startup un vocabulaire simple, stable, qui ferait plus directement référence à ces valeurs de la communauté.
Équipe produit, expérimentation de politique publique, pratiques auto-gestionnaires, développement incrémental, recherche d’impact, amélioration continue, lutte contre le digital bullshit… on peut cerner le réel, mais il est difficile de toucher en un ou deux mots son essence pour le défendre auprès des décideurs. Faute de trouver mieux dans ces champs d’inspiration, la terminologie Startup d’État a été conservée jusqu’à présent.
Mais à tous les sceptiques qui pourraient penser que cette pensée n’est que l’otage d’un « New Public Management », transposition naïve de pratiques du privé dans le public ou que l’on peut disqualifier d’un revers de main les GAFA (= mal) contre un secteur public (= bien), nous nous devons de poursuivre la déconstruction d’une méthode qui elle même n’est pas un dogme mais un apprentissage collectif, en amélioration continue. Dans un monde où toutes les grandes organisations, publiques comme privées, sont confrontées à un paternalisme autoritaire archaïque, même des plateformes précarisantes et fiscalement ingrates peuvent par certains aspects inspirer des organisations publiques.
Nobody Gives a Hoot About Profit
Dr Edward Deming
La nécessaire polarisation sur l’impact (le sens) a été forgée par des théoriciens des organisations comme Eliyahu Goldratt (auteur notamment de Le BUT, et père de la théorie des contraintes) ou Edward Deming (la principale autorité morale du lean management), qui constatent qu’invariablement, les moyens se substituent aux fins dans les grandes organisations en silos. Cette perte de sens est particulièrement douloureuse dans le secteur public où les gens sont et restent par vocation, par volonté de servir l’intérêt général.
Ivan Illich modélise lui aussi brillamment cette perte de sens par la trahison des « professions dominantes » dans un essai séminal « La convivialité ».
« L’outil simple, pauvre, transparent est humble serviteur ; l’outil élaboré, complexe, secret est un maître arrogant. » Ivan Illich
(le lecteur pourra donc librement placer Chorus, la T2A, les préfectures Nouvelles Génération ou le système de formation professionnelle dans la catégorie la plus adaptée)
La confiance dans des équipes plus que dans des plans a des racines systémiques également (l’impossibilité de dessiner le plan d’un système complexe, largement indéterminé), mais aussi Fourierristes – le mouvement coopératif – racines réifiées par la contre-culture communautaire et auto-gestionnaire de la Silicon Valley (excellent article du 1 à ce sujet) qui a largement irrigué la pensée des informaticiens.
Mais elle s’inspire aussi des sociologues modernes comme Michel Crozier qui a parfaitement décrit comment les règles du jeu dans les systèmes établis forçaient le statu quo et inhibaient la plupart des innovations en ce qu’elles étaient structurellement perturbatrices du jeu en place.
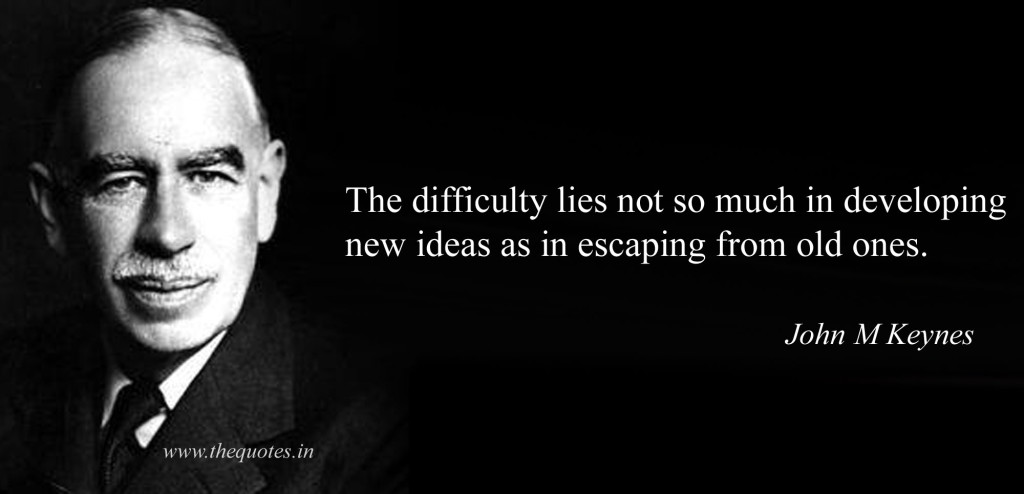
Ce constat nous a poussé à imaginer un espace, beta, où ne s’imposent pas toutes les règles du système, pour mieux y revenir une fois la preuve obtenue qu’il est possible de l’améliorer. C’est une pierre angulaire majeure de notre démarche, mais provoque régulièrement la critique : « pourquoi ne pas le faire avec les Directions habituelles ? » « comment prétendez-vous faire mieux que les personnes en charge ? » « nous voulons faire des Startups d’État avec l’organisation en place, pas contre ».

Dans son « Pourquoi j’ai mangé mon père », l’écrivain et économiste Roy Lewis parvient à vulgariser cette double légitimité des conservateurs (« ne touchez pas au système, il marche ») et des innovateurs (« on peut faire mieux, mais il va falloir changer une règle profonde »), mais l’impossibilité structurelle à aligner leurs intérêts au départ : l’inventeur du feu a raison, mais son adversaire a tout aussi raison.
Enfin, de la “startup”, je retiens l’esprit de conquête, ce désir que ce qui a fonctionné à Puy-l’Évêque puisse bénéficier au pays tout entier et au coût marginal le plus faible possible.
Dans cet exemple, la solution généralisée par pôle Emploi pour aider les entreprises qui ne parviennent pas à embaucher depuis plus de 30 jours va nécessiter 1000 postes supplémentaires. Il n’y avait peut-être pas de meilleure idée, mais dans une approche Startup d’État, l’automatisation de tout ou partie de la valeur ajoutée validée dans l’expérimentation aurait été tentée avant cette généralisation.
On pourra donc dire que le corpus de valeurs qui a inspiré beta.gouv.fr s’apparente à celles du mouvement coopératif (des phalanstères autonomes plus que des silos industriels), à la systémique (appréhender le système dans sa globalité, ses buts, ses goulets d’étranglement, plus que par la somme de ses parties), aux méthodes agiles et leur attention constante à l’usager (des systèmes qui s’améliorent sans fin plutôt que le tragique projet/maintenance des cycles en V), à la contre-culture (l’économie du partage, de Wikipedia à Blablacar, qui fournira ici des Politiques Publiques Participatives), aux rendements croissants des startups (l’utilité pour un usager coûte de moins en moins cher) et à la sociologie des systèmes bureaucratiques (une vision centrée sur les acteurs et leur jeu plus que sur le système et son hypothétique déterminisme en rôles et processus).
L’adaptation du service public, son principe de mutabilité, est inscrit dans le droit public. Pourtant partout, nous constatons qu’il est plutôt en maintenance, et que malgré les nombreux simulacres de mesure de la qualité, aucune dynamique d’amélioration continue n’y est structurelle.
Depuis Michel Crozier, nous savons que le changement ne s’impose ni ne se planifie, il est avant tout un apprentissage collectif. Nous ne savons pas à quel point le mode « phalanstère » peut se développer (verra-t-on des collèges ou des agences pôle emploi autonomes ?) A quel point l’on peut contester les monopoles des grandes fonctions support qui s’imposent à ces unités terrain (verra-t-on plusieurs plateformes pédagogiques autorisées à l’Éducation Nationale ?) ? Dans nos organisations futures, verra-t-on un mix du modèle hiérarchique, paternaliste et autoritaire avec un mode communautaire, ou ces cultures doivent l’une ou l’autre dominer ? A nous de poursuivre ce dialogue fécond, en travaillant d’abord sur le terrain plus que sur celui de l’idéologie.
Tout est contestable dans ce nous avons essayé puisque cela appartient à la sphère publique, mais est-il vraiment contestable d’essayer des méthodes qui renvoient au sens même de l’action publique dans des administrations qui – indépendamment de ce que l’on pense de leur bon niveau de financement – sont rongées par le burnout, le désengagement et les bullshit jobs ?
Laisser un commentaire